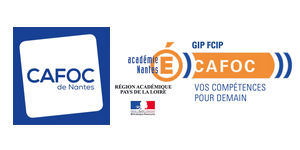Détail de l'auteur
Auteur Christine MAUTRET-LABBE |
Documents disponibles écrits par cet auteur (2)


 Affiner la recherche Interroger des sources externes
Affiner la recherche Interroger des sources externesILLETTRISME : LE DEPASSER ET CONSTRUIRE : DOSSIER / Eliane BOUYSSIERE-CATUSSE in EMPAN, N° 81 (2011)
Titre : ILLETTRISME : LE DEPASSER ET CONSTRUIRE : DOSSIER Auteurs : Eliane BOUYSSIERE-CATUSSE ; Pierre ROQUES ; ZAOUCHE GAUDRON ; FEDERATION DES ENTREPRISES DE PROPRETE ; Anne VINERIER ; Eric NEDELEC ; Claire HEBER-SUFFRIN ; Bernard BENSIDOUN ; Bernard MOLINIE ; Laëtitia VIOLET-CHARTIER ; Françoise SALVAT ; Alexandre MEUNIER ; Frédéric GALIBERT ; Thomas DUMET ; Véronique LECLERCQ ; Catherine JOHN ; Christine MAUTRET-LABBE ; Rémy PUYUELO Année de publication : 2011 Article en page(s) : pp. 10-97 Catégories : ACTION FORMATION
DYSLEXIE
ECHANGE SAVOIR
ILLETTRISME
PRISONRésumé : L'illettrisme touche une population de 3.100.000 personnes, soit 9 % de la population âgée de 18 à 65 ans, vivant en France métropolitaine et ayant été scolarisée en France mais qui a perdu la pratique de l'écrit au point d'être «incapable de lire et d'écrire un exposé simple et bref de faits en rapport avec la vie quotidienne» (UNESCO).
Quelles sont les caractéristiques de cette population ?
Alors que pour comprendre le monde et y prendre une place d'acteur citoyen, l'accès à l'écrit s'avère indispensable, ces personnes, pour survivre, doivent développer des stratégies d'évitement voire de déni mais aussi de contournement résolument inventives.
Comment vivent-elles leur situation au quotidien ?
Qu'est-ce qui interdit le processus d'appropriation de la langue écrite ?
Peut-on parler de manque, de souffrance ?
Quels en sont les modes d'expression ?
Quels processus d'adaptation, ou de désadaptation, sont-ils nécessaires ?
Comment les politiques publiques, les institutions et le monde du travail appréhendent-ils le problème de l'illettrisme ?
Des témoignages des lieux ressources, des actions associatives novatrices et des illettrés eux-mêmes apporteront matière à réflexion.
[Résumé de l'éditeur (site Internet)]
Au sommaire de ce dossier :
1. DES PRATIQUES DE FORMATION :
. Quelle place pour les apprenants dans la compréhension de la problématique de l'illettrisme ?
. Les Actions éducatives familiales ou comment réunir en une seule action prévention et lutte contre l'illettrisme
. Dix ans d'engagement en faveur de la lutte contre l'illettrisme
. Les Réseaux d'échanges réciproques de savoirs
. La Métaphore !
. Gouttes de nuit
2. DES PUBLICS SPECIFIQUES :
. Adolescents dits difficiles et illettrisme
. Un seul bras ne fait pas le tour du baobab...
. Un rempart contre le vide ?
. L'illettrisme à l'établissement pénitentiaire pour mineurs
. Des parents maîtrisant mal l'écrit face à l'école
. Les dysphasiques, qui sont-ils ?
. La Llobera.Permalink : http://www.acteursfpl.paysdelaloire.fr/pmb/opac_css/index.php?lvl=notice_display
in EMPAN > N° 81 (2011) . - pp. 10-97[article] ILLETTRISME : LE DEPASSER ET CONSTRUIRE : DOSSIER [] / Eliane BOUYSSIERE-CATUSSE ; Pierre ROQUES ; ZAOUCHE GAUDRON ; FEDERATION DES ENTREPRISES DE PROPRETE ; Anne VINERIER ; Eric NEDELEC ; Claire HEBER-SUFFRIN ; Bernard BENSIDOUN ; Bernard MOLINIE ; Laëtitia VIOLET-CHARTIER ; Françoise SALVAT ; Alexandre MEUNIER ; Frédéric GALIBERT ; Thomas DUMET ; Véronique LECLERCQ ; Catherine JOHN ; Christine MAUTRET-LABBE ; Rémy PUYUELO . - 2011 . - pp. 10-97.
in EMPAN > N° 81 (2011) . - pp. 10-97
Catégories : ACTION FORMATION
DYSLEXIE
ECHANGE SAVOIR
ILLETTRISME
PRISONRésumé : L'illettrisme touche une population de 3.100.000 personnes, soit 9 % de la population âgée de 18 à 65 ans, vivant en France métropolitaine et ayant été scolarisée en France mais qui a perdu la pratique de l'écrit au point d'être «incapable de lire et d'écrire un exposé simple et bref de faits en rapport avec la vie quotidienne» (UNESCO).
Quelles sont les caractéristiques de cette population ?
Alors que pour comprendre le monde et y prendre une place d'acteur citoyen, l'accès à l'écrit s'avère indispensable, ces personnes, pour survivre, doivent développer des stratégies d'évitement voire de déni mais aussi de contournement résolument inventives.
Comment vivent-elles leur situation au quotidien ?
Qu'est-ce qui interdit le processus d'appropriation de la langue écrite ?
Peut-on parler de manque, de souffrance ?
Quels en sont les modes d'expression ?
Quels processus d'adaptation, ou de désadaptation, sont-ils nécessaires ?
Comment les politiques publiques, les institutions et le monde du travail appréhendent-ils le problème de l'illettrisme ?
Des témoignages des lieux ressources, des actions associatives novatrices et des illettrés eux-mêmes apporteront matière à réflexion.
[Résumé de l'éditeur (site Internet)]
Au sommaire de ce dossier :
1. DES PRATIQUES DE FORMATION :
. Quelle place pour les apprenants dans la compréhension de la problématique de l'illettrisme ?
. Les Actions éducatives familiales ou comment réunir en une seule action prévention et lutte contre l'illettrisme
. Dix ans d'engagement en faveur de la lutte contre l'illettrisme
. Les Réseaux d'échanges réciproques de savoirs
. La Métaphore !
. Gouttes de nuit
2. DES PUBLICS SPECIFIQUES :
. Adolescents dits difficiles et illettrisme
. Un seul bras ne fait pas le tour du baobab...
. Un rempart contre le vide ?
. L'illettrisme à l'établissement pénitentiaire pour mineurs
. Des parents maîtrisant mal l'écrit face à l'école
. Les dysphasiques, qui sont-ils ?
. La Llobera.Permalink : http://www.acteursfpl.paysdelaloire.fr/pmb/opac_css/index.php?lvl=notice_display SURDITES : ENTRE HANDICAP ET MINORITE CULTURELLE : DOSSIER / Marie-Laure BERALS in EMPAN, N° 83 (SEPTEMBRE 2011)
Titre : SURDITES : ENTRE HANDICAP ET MINORITE CULTURELLE : DOSSIER Type de document : texte imprimé Auteurs : Marie-Laure BERALS ; Lin GRIMAUD ; Paule SANCHOU ; Benoît VIROLE ; Andrea BENVENUTO ; Florence ENCREVE ; Emilie SEYES ; Virginie DENIS ; Christophe TOUCHAIS ; Anne HONEGGER ; André MEYNARD ; Nathalie CLAVIER ; Jacques LAGARRIGUE ; Véronique SORIANO ; Jean DAGRON ; Marie ESPONDE ; Nicolas CARRERE-BORDEHORE ; Mireille GOLASZEWSKI ; Corinne SARRAZIN-AURIOL ; Claudine HACKIERE ; Lydie CANDEIAS ; Catherine JOHN ; Christine MAUTRET-LABBE ; Corinne BLOUIN ; Claire-Marie PYLOUSTER ; Cécile GARCIA Année de publication : 2011 Article en page(s) : pp. 11-129 Langues : Français (fre) Catégories : HANDICAP
RESSOURCES HANDICAPRésumé : La surdité pose la question de la communication humaine du point de vue de la technique - médicale, pédagogique, linguistique - mais aussi sous les aspects psychosociaux des échanges intra et inter groupes.
Au-delà des problèmes sociolinguistiques, elle induit des questionnements sociopolitiques plus larges. Elle interroge aussi la contrainte du remaniement identitaire individuel impliqué dans toute construction de liens d'appartenance groupale.
Affectant la communication, la surdité tend à être représentée comme un événement social négatif. Pourtant, subvertissant l'identité induite d'handicapés, les sourds ont, de longue date, généré de la réalité sociale en se constituant en entité sociopolitique, par le biais notamment de l'invention et de la légitimation de la langue des signes.
Parallèlement, le développement des technologies médicales, notamment de l'implant cochléaire qui permet aux sourds d'entendre le langage vocal - s'il constitue une avancée capitale, donnant espoir aux parents et ouvrant l'enfant sourd sur le monde - pose un nouveau problème. En effet, l'implant ne va-t-il pas faire de la surdité une entité clinique vide et de la communauté sourde un groupe social désaffecté ?
Ce dossier propose une série de travaux, de réflexions et de témoignages organisée en quatre parties :
- les sourds entre handicap et communauté. Eléments d'analyse historique, sociale et phénoménologique de la surdité ;
- entre la langue des signes et l'implant cochléaire : une controverse ;
- dépistage précoce, annonce du diagnostic, première socialisation en crèche ;
- la scolarité de l'enfant sourd jusqu'à l'université.Permalink : http://www.acteursfpl.paysdelaloire.fr/pmb/opac_css/index.php?lvl=notice_display
in EMPAN > N° 83 (SEPTEMBRE 2011) . - pp. 11-129[article] SURDITES : ENTRE HANDICAP ET MINORITE CULTURELLE : DOSSIER [texte imprimé] / Marie-Laure BERALS ; Lin GRIMAUD ; Paule SANCHOU ; Benoît VIROLE ; Andrea BENVENUTO ; Florence ENCREVE ; Emilie SEYES ; Virginie DENIS ; Christophe TOUCHAIS ; Anne HONEGGER ; André MEYNARD ; Nathalie CLAVIER ; Jacques LAGARRIGUE ; Véronique SORIANO ; Jean DAGRON ; Marie ESPONDE ; Nicolas CARRERE-BORDEHORE ; Mireille GOLASZEWSKI ; Corinne SARRAZIN-AURIOL ; Claudine HACKIERE ; Lydie CANDEIAS ; Catherine JOHN ; Christine MAUTRET-LABBE ; Corinne BLOUIN ; Claire-Marie PYLOUSTER ; Cécile GARCIA . - 2011 . - pp. 11-129.
Langues : Français (fre)
in EMPAN > N° 83 (SEPTEMBRE 2011) . - pp. 11-129
Catégories : HANDICAP
RESSOURCES HANDICAPRésumé : La surdité pose la question de la communication humaine du point de vue de la technique - médicale, pédagogique, linguistique - mais aussi sous les aspects psychosociaux des échanges intra et inter groupes.
Au-delà des problèmes sociolinguistiques, elle induit des questionnements sociopolitiques plus larges. Elle interroge aussi la contrainte du remaniement identitaire individuel impliqué dans toute construction de liens d'appartenance groupale.
Affectant la communication, la surdité tend à être représentée comme un événement social négatif. Pourtant, subvertissant l'identité induite d'handicapés, les sourds ont, de longue date, généré de la réalité sociale en se constituant en entité sociopolitique, par le biais notamment de l'invention et de la légitimation de la langue des signes.
Parallèlement, le développement des technologies médicales, notamment de l'implant cochléaire qui permet aux sourds d'entendre le langage vocal - s'il constitue une avancée capitale, donnant espoir aux parents et ouvrant l'enfant sourd sur le monde - pose un nouveau problème. En effet, l'implant ne va-t-il pas faire de la surdité une entité clinique vide et de la communauté sourde un groupe social désaffecté ?
Ce dossier propose une série de travaux, de réflexions et de témoignages organisée en quatre parties :
- les sourds entre handicap et communauté. Eléments d'analyse historique, sociale et phénoménologique de la surdité ;
- entre la langue des signes et l'implant cochléaire : une controverse ;
- dépistage précoce, annonce du diagnostic, première socialisation en crèche ;
- la scolarité de l'enfant sourd jusqu'à l'université.Permalink : http://www.acteursfpl.paysdelaloire.fr/pmb/opac_css/index.php?lvl=notice_display